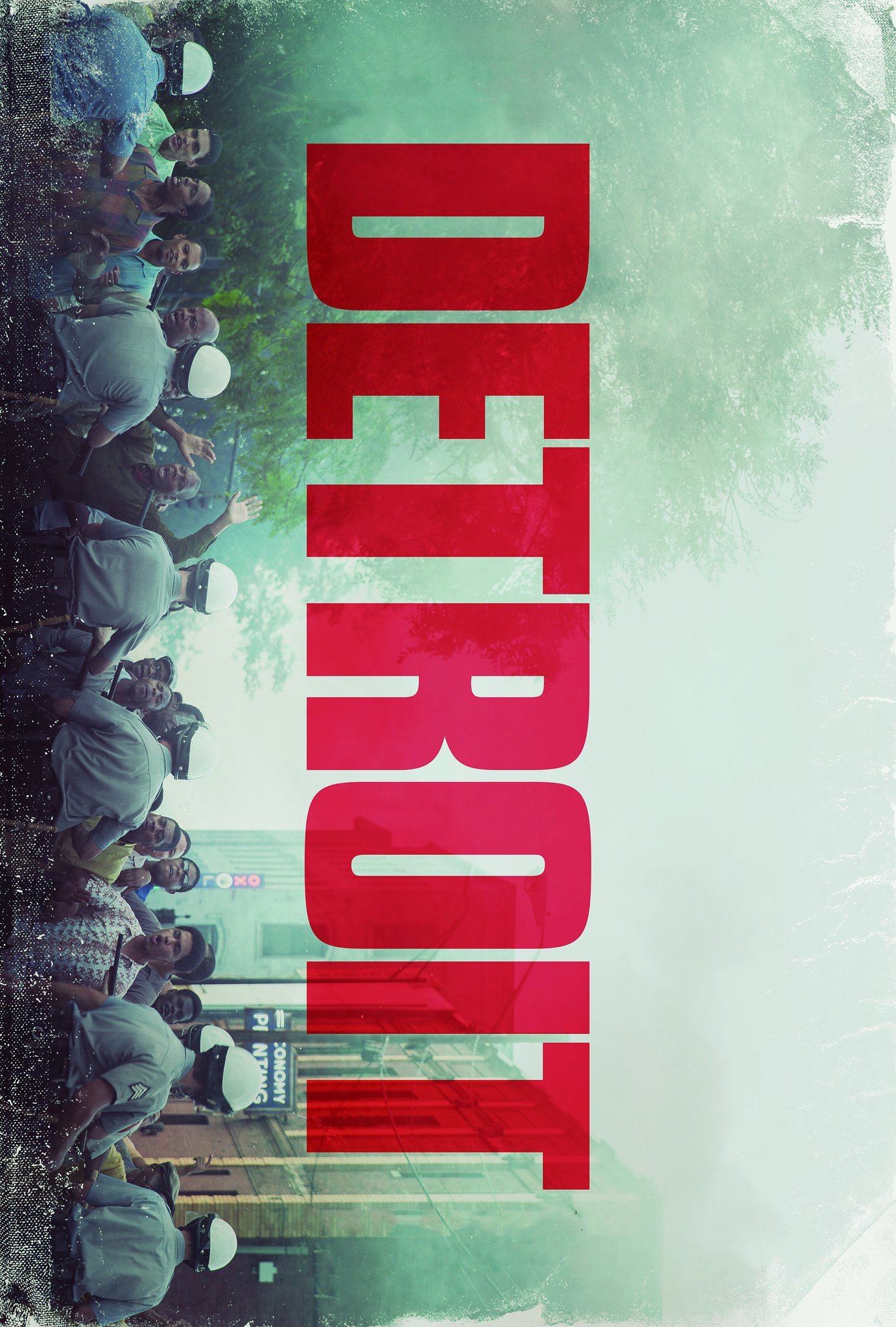Armée de son regard fascinant, Kathryn Bigelow nous amène à nouveau à questionner toute la bêtise derrière notre violence, et toute la haine derrière nos fondations, et notre présent.
Seule OscariséÉ à ce jour (Démineurs en 2010), Kathryn Bigelow est de retour sur nos écrans cette semaine avec Detroit, un brûlot éminemment politique sur la ‘question noire’ aux USA dans les années ’60, à la résonance actuelle glaçante. En effet, la réalisatrice y relate une nuit tristement célèbre des émeutes de la 12ème rue. Celles-ci sont survenues à Detroit en 1967 en réaction à la condition déplorable de la population afro-américaine et aux tensions raciales dans le nord du pays. Au coeur des immeubles enflammés, des épiceries pillées et des bâtisses dévastées travaillent et/ou survivent les protagonistes de l’épisode tragique du motel Algiers, peu connu de notre côté de l’Atlantique. Le vrai sujet du film: la sauvagerie des vrais coupables, et leur absurde immunité.
C’est avec sa caméra embarquée que la réalisatrice de Point Break nous impose l’effarante réalité – passée et présente – des violences policières, et nous renvoie aux démons d’une Amérique toujours en plein doute sur son identité, et son vrai visage. Orchestral, le film est composé de trois chapitres distincts: la mise en place du contexte socio-politique, la scène choc du motel (45 minutes de ‘torture‘ physique et psychologique), et le déroulement du procès quelques années plus tard. En résumé: un huis clos fabuleux aux allures de home invasion horrifique, inoubliable, en sandwich entre une reconstitution solide et un film de procès en deçà du reste. Entre les changements de perspective induits par les personnages et ce déséquilibre, Detroit passionne, estomaque, avant de laisser pantois. Les faits n’en restent pas moins cinématographiques, pour une appropriation salutaire.
Axé autour d’une galerie de personnages diamétralement opposés (une chorale de chanteurs soul voulant rêvant de signer chez Motown, un agent de sécurité noir débordant de valeurs humanistes so american, deux touristes éclatantes de jeunesse, et une bande de flics aux leaders complètement dépassés par leur petit pouvoir sur leurs détenus), le film est porté par un casting fidèle à l’Histoire, avec notamment John Boyega (Star Wars VII & VIII), Antony Mackie (Captain America, Avengers) et Kaitlyn Dever (Short Term 12), retenus avec audace et brio; un sans-faute absolu côté distribution.
À défaut d’une analyse systémique de l’éclatement des violences dans la ville du Michigan, Detroit propose un quasi-documentaire magistralement mis en scène; concentré de sang, sueur, larmes et hurlements, nous emmenant naturellement à nous élever bien au-delà de son contenu. Après nous avoir brillamment installés dans son époque complexe grâce à la photographie sublime de Barry Ackroyd, Kathryn Bigelow nous invite ainsi à la retranscription empreinte de brutalité d’un événement au cours duquel trois jeunes afro-américains furent abattus par un trio de flics blancs racistes et tordus. L’ignorance, la crainte, l’envie, … le portrait est dressé.
Pendant près de 2h30, c’est à travers une esthétisation millimétrée du dolorisme (et de toute l’oppression silencieuse et insupportable subie par tant de femmes et d’hommes chaque jour) que Detroit impose le respect, à bien des points de vue. Sa bande originale aux accents gospel et soul accompagne le tout parfaitement, avec la création d’une atmosphère ancrée dans la représentation de son temps. En parallèle, la scène du revolver sur la tempe n’est pas sans rappeler le documentaire I Am Not Your Negro de Raoul Peck sorti l’an dernier, et sa triste parabole: la différence lorsque l’on est noir aux États-Unis, c’est que l’on sait qu’on peut mourir à chaque fois que l’on sort de chez soi. Dès lors, un tel film ne peut parler à tout le monde de la même manière, et c’est là sa richesse.

Loin de proposer une division manichéenne de son pays en deux camps symétriques, la cinéaste enrichit la trame simple du motel de personnages divers qui viennent ‘nuancer’ les monstruosités commises et le bon caractère des otages. Ainsi, les membres des forces de l’ordre sont loin de tous cautionner l’attitude des meurtriers, tandis de nombreux manifestants noirs prônent la révolution par le vol, le crime et la haine. Le seul vrai défaut de Detroit: une fin aux airs de film de plaidoiries aux accents dramatiques un peu lourds, et un final qui parait paradoxalement trop américanisé dans sa conclusion du conflit. Nous préférons ne rien révéler, mais prêtez attention au générique.
S’il peut déranger par le naturalisme de sa mise en scène, Detroit ne tient de torture que ses portées morale et politique. Le film use des images et arguments nécessaires à une prise de conscience qui, tristement, semble ne jamais aboutir, même un demi-siècle après le massacre de l’Algiers (et les multiples autres violences policières depuis). Detroit peut, par extrapolation, provoquer le même feeling voyeur et dérangeant qu’une vidéo d’assassinat similaire diffusée sur les réseaux sociaux ou à la télévision. De ce fait, il scandalise avec une puissance identique, malgré son caractère de ‘divertissement’. Tandis que certains défendront la non-nécessité d’enfoncer les portes ouvertes sur des sujets aussi polémiques (ou accuseront la réalisatrice de chercher les récompenses en rebondissant sur l’actualité), il est impossible de renier l’art de la caméra de Kathryn Bigelow, et l’émotion renvoyée par son amour pour ses acteurs, pour une véritable leçon de maestria technique et de gestion du tempo, deux éléments qui manquent cruellement à la troisième partie.
En se concentrant sur la peur et la haine, la cinéaste y tombe dans le piège du ‘film à montrer à l’école’. Si l’issue du procès est indispensable au scénario, sa rupture involontaire avec la tension des deux premiers tiers les condamne, sans catastrophe. Il n’empêche, Detroit promet une séance riche, tant sur le versant historique que pour sa qualité formelle d’écriture et de réalisation.
Enfin, les interprétations des comédiens y sont irréprochables, avec une mention spéciale pour Algee Smith qui, au-delà de nous bouleverser tout au long d’un métrage étouffant, nous offre quelques interludes musicaux cristallins, bienvenus dans ce chaos ambient. Son timbre angélique devrait vous précipiter vers vos vieux albums Marvin Gaye à la sortie de la séance. Quant à Will Poulter, son choix pour le very bad cop Krauss est un pari remarquable. Copain de Leo dans The Revenant, repéré dans des productions au ton bien plus léger (We’re the Millers, The Maze Runner), confirme ici l’essai haut la main, et campe le cliché du flic chauvin, crédule et raciste à la perfection.
En conclusion, Detroit nous donne envie de dire merci à Kathryn Bigelow. Si la nécessité et la légitimité du film risquent de faire parler, son oeuvre réussit un double exploit: nous dégoûter du monde, tout en nous confortant dans nos idéaux. Même s’il souffre parfois de schématisme, il offre avant tout la réécriture multicolore d’une problématique fatalement enracinée, autour de laquelle le questionnement se doit de continuer, encore. Constatation amère à la sortie du cinéma: les injustices paraissent parfois si prévisibles et évidentes que la Terre semble toujours incapable de tourner rond. Reste à voir la conséquence du film, que l’on redoute imperceptible, comme trop souvent. Peu importent les élites et les systèmes, c’est pourtant en nous que se tient le vrai changement.
En tous cas pour nous, Detroit est une réussite aussi bien sur la forme, que sur le fond.
#GOKATHRYN